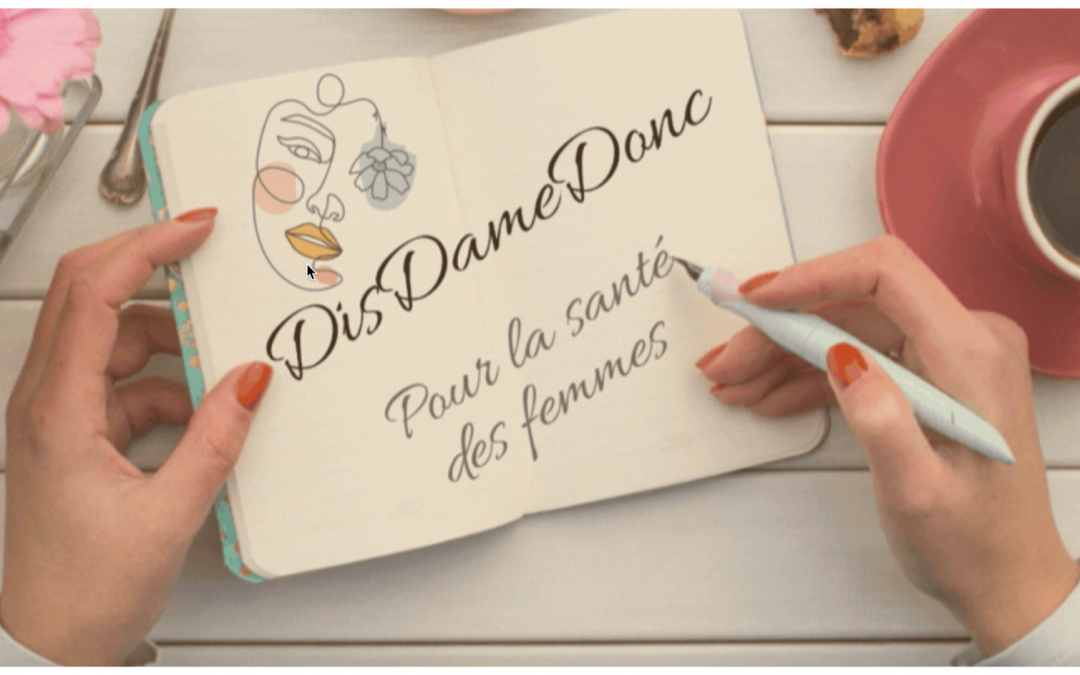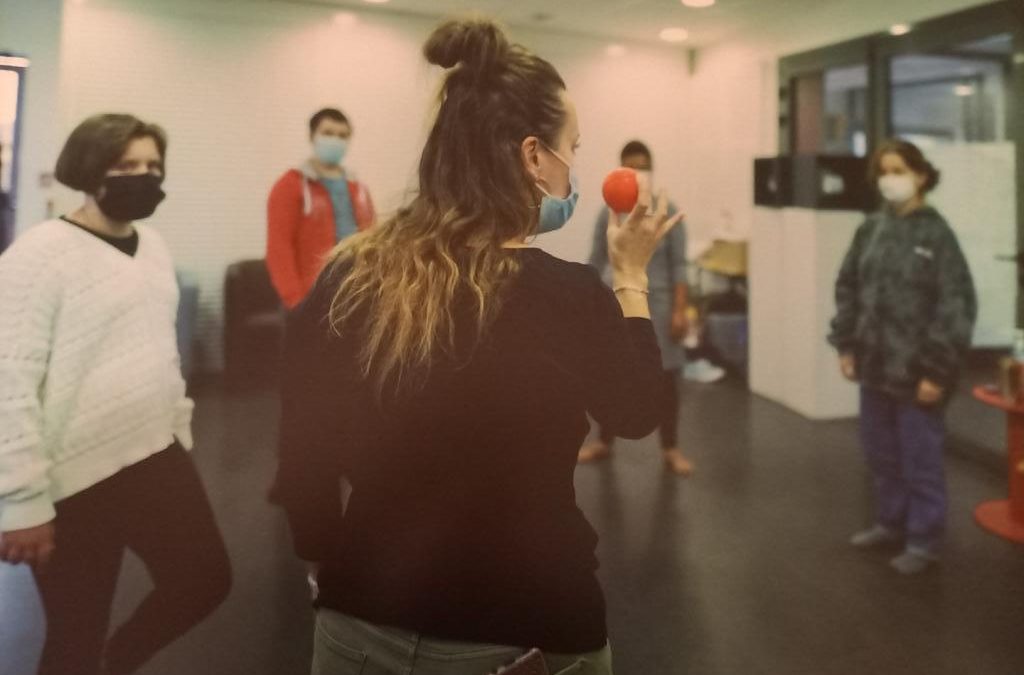par admin_asi | Juil 11, 2024 | Non classé
En 1960, Simone de Beauvoir écrivait dans son ouvrage, La Vieillesse, « le sens de notre vie est en question dans l’avenir qui nous attend. Nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes si nous ne savons pas qui nous serons. » Ce vieil homme ? Cette vieille femme ? Nous...
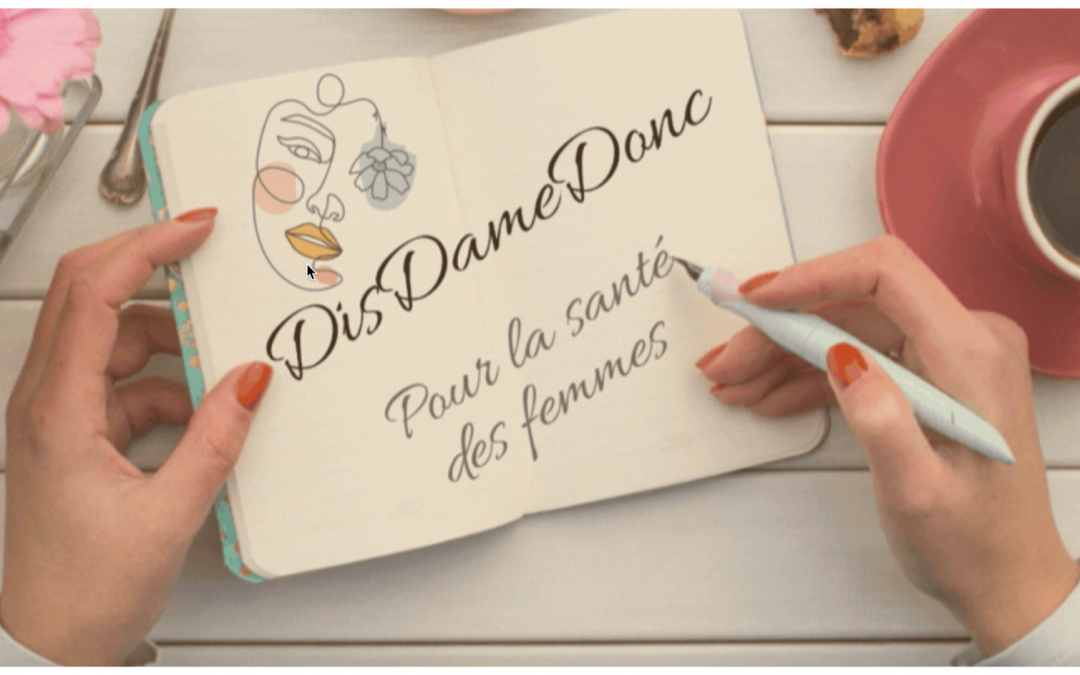
par admin_asi | Mai 29, 2024 | ASI finance
L’ASI soutient : 5000€ au profit de « Dis Dame Donc » Dans le cadre de notre engagement en faveur de la santé environnementale, le fonds de dotation ASI est fier de soutenir l’association Dis Dame Donc. Cette association, œuvre pour une meilleure prise en compte des...

par admin_asi | Mai 29, 2024 | ASI finance
L’ASI soutient : 5000€ au profit de « l’ARSLA » Dans le cadre de notre engagement en faveur du soutien aux aidants, le Fonds de dotation ASI est fier de soutenir l’Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique (ARSLA). Cette...
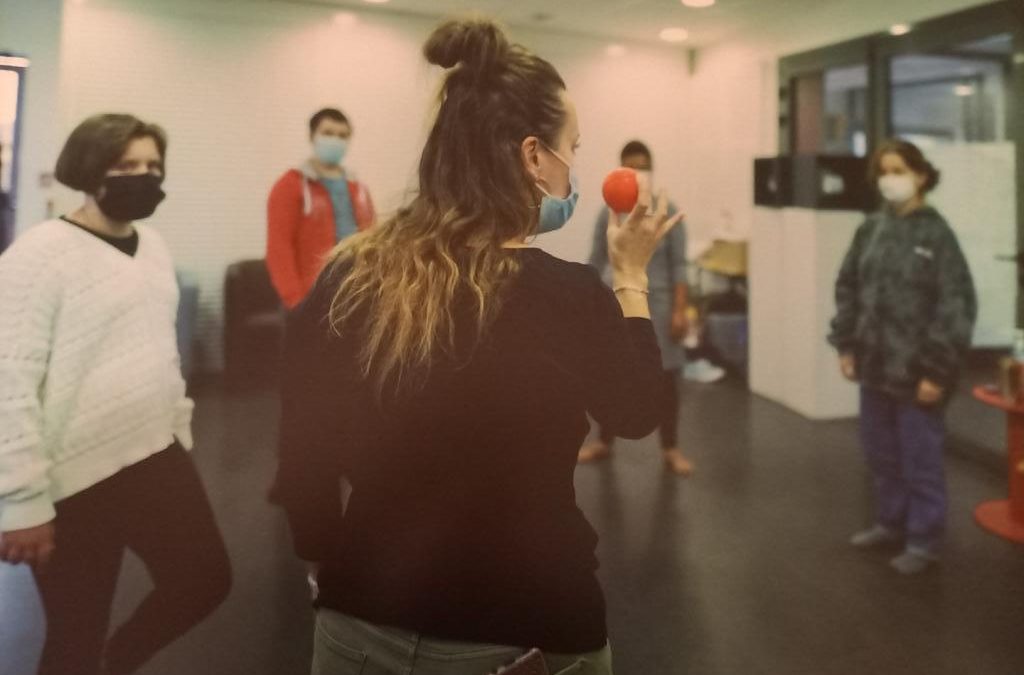
par admin_asi | Mai 28, 2024 | Entretien
ART THÉRAPIE : REMÈDE DOUX OU EXUTOIRE ? Éléments de réponse autour de la pratique théâtrale Selon l’IRFAT (Institut de Recherche et de Formation en Art-Thérapie), l’art-thérapie se définit comme l’utilisation psychothérapeutique de la pratique artistique dans le...

par admin_asi | Mai 27, 2024 | Boîte à outils
La détection précoce des cancers demeure un élément essentiel dans la prévention et le traitement de la maladie. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, elle permet une diminution significative du taux de mortalité, pouvant aller jusqu’à 20% selon le...